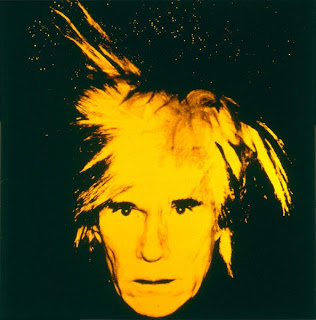Hier, dans ma voiture, j'écoutais Daniel Mermet sur France-Inter. Le bon Daniel, pour nous convaincre que la radio de service public n'est plus comme la radio de papa, nous a offert un florilège de chroniques prises dans les archives de Radio France.
D'abord, une chronique de Michel Droit, obscur académicien et amateur de safaris africains aux temps du giscardisme triomphant, fustigeant la liberté sexuelle et en particulier celle éclosant sur les écrans de ciné dans les années 70. Ensuite, remontée dans le temps: la France de Vichy, celle de Radio-Paris, avec la voix de Philippe Henriot, collabo notoire et fusillé à la Libération, déversant ses invectives contre le résistant Pierre Dac qui avait rejoint De Gaulle en Angleterre. Suit la réponse de Pierre Dac, magnifique plaidoyer en faveur de ses origines alsaciennes et d'un père disparu dans les tranchées de la Marne. Après, retour aux années 60, où un chroniqueur dont j'ai oublié le nom, s'en prenait à l'existentialisme et à ce sale gaucho de Sartre, à tous ces vilains jeunes qui se droguent en écoutant de la musique de sauvage, etc.
Et tout ça, pour prouver quoi aux auditeurs dont je suis? Qu'aujourd'hui, c'est mieux qu'hier? Que Pierre Dac vaut mieux qu'un collabo? Que l'Histoire retiendra Sartre et pas ce semi-gâteux de Michel Droit? Mais ça, on le savait, non? Alors, où veut-il en venir ce bon Daniel?
A pas grand-chose. A nous faire la morale, comme d'habitude. Ou plutôt, à nous faire "la moraline", succédanné humanisant très prisé chez les vieux babas et les jeunes bobos qui voient du fascisme partout.
Bref, impossible d'être contre, à moins de préférer Henriot à Pierre Dac! Avec Mermet, pas de problème: on pratique l'esprit critique sans peine. Et puis, grâce à lui, on sait enfin - au cas où on l'aurait oublié - où sont le Bien et le Mal. Le Mal est fatalement réac et le Bien toujours progressiste. A ce compte-là, si on regarde la littérature, il y a sans doute beaucoup d'auteurs que Mermet - ce saint progressiste - doit s'interdire de lire, ou alors en cachette; en vrac, on peut citer Molière (soutenu par ce facho de Louis XIV), Chateaubriand (de vieille noblesse bretonne, carrément facheux), Flaubert (pas vraiment copain avec La Commune, celui-là), ou encore Maupassant (super réac de chez réac, et syphilitique en plus!), etc.
On me dira: quel rapport avec l'émission d'hier?
Qu'il est facile, quand on a une heure d'antenne, d'enfoncer des portes ouvertes en prenant des accents de libérateur guévariste, d'égréner des lieux communs en se posant comme un libertaire de studio. Ca ne fait de mal à personne, mais ça n'aide pas non plus à penser.
Bref, à force de fustiger les méchants, Daniel Mermet finit par devenir la caricature de ceux qu'il dénonce: un petit Fouquier-Thinville braillard, qui voudrait nous convaincre que le monde d'aujourd'hui se sépare entre les méchants cow-boys et les gentils indiens.
Salut, Daniel Gnangan! En ce qui me concerne, je crois que je vais aller me remettre une chanson de Jacques Dutronc. Celui-là, au moins, n'a jamais fait la leçon à personne!